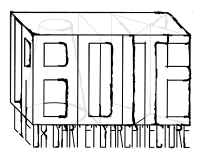- +216 71 772 000
- laboite@kilanigroupe.com
- Du lundi au vendredi, de 11h à 17h.
Farah Khelil
«L’inspiration a-t-elle des mains ou est-elle somnambule ?»
Juin 2015 I Décembre 2015
La Boîte I Un lieu d’art contemporain
L’informe
Projetés au mur, les mots sont des points et les points, eux, ne sont progressivement plus des mots. On en oublierait presque, en voyant cette nuée blanche se détacher du fond noir que les lettres, les mots, les phrases ne sont au départ que des ensembles de lignes et que c’est seulement après avoir été assemblées, composées, structurées qu’elles deviennent signifiantes. Ainsi arrachée au royaume de l’informe, la ligne mutée en écriture s’agrippe au corps du concept ; le tracé jadis libre investit le rôle, plus servile, d’intermédiaire au réel – de cloisonnement du réel.
« Le voir précède le mot. L’enfant regarde et reconnaît bien avant de pouvoir parler.
Mais le voir précède également le mot en ce sens que c’est en effet la vue qui marque notre place dans le monde : les mots nous disent le monde mais les mots ne peuvent pas défaire ce monde qui les a fait. »
Les mots qu’emploie John Berger pour débuter Voir le voir, précieux ouvrage portant sur l’analyse des images, mettent en évidence que comprendre le monde, c’est aussi, le nommer. Mais qu’en le nommant, le monde se trouve coincé dans l’emprise de la mécanique qui sert à le dire, n’offrant ainsi plus les outils qui serviraient à le dégager de ses rouages. Libérer le mot de la complexité du langage pour le ramener au magma primitif qui a permis son existence (et « défaire notre « réel » sous l’effet d’autres découpages. » comme dirait Roland Barthes), cela revient ainsi souvent à avouer une certaine crise de la communication, qu’elle soit intime ou collective.
Bruit, la vidéo de Farah Khelil à laquelle les premières lignes de ce texte font référence, incarne un moment de crise par l’atomisation du langage. Sur le mur où elles sont projetées, les phrases se superposent et de cet empilement naît un bruit qui n’exprime pas le son, mais les parasites dont on qualifierait un message brouillé, une information en voie de se perdre. Empruntées à un manuel d’apprentissage de l’écriture arabe, les mots assemblés sont autant de sentences normatives inculquées à l’élève qui rejoignent, sous les yeux du regardeur, le champ mutique de l’indiscernable. Dans un même mouvement de perturbation portée à la transmission du message, l’artiste a reporté sur un ensemble de plaques en plexiglas les phrases qui composent le manuel. Si la technique employée ici est similaire à celle du braille, le tracé en relief des lettres suit les courbes de l’alphabet arabe et campe dans un registre de communication initialement destiné aux voyants. L’œuvre s’adresse donc au toucher sans passer par le braille et, par ce procédé, ne se raccorde à aucun système valide de langage ni de transmission de l’information ; sa matérialité apparaît alors tel un rail guidant le doigt à la faillite du discours et des idées. En admettant que, comme il est dit plus haut, le voir précède le mot, on conviendra que le toucher précède le voir et qu’ici à nouveau, le travail de Farah Khelil ne s’incarne pas dans l’absence de forme mais dans l’étreinte de l’informe.
Pour paraphraser Georges Bataille, l’informe est ce qui échappe à toute catégorisation et vient, par là-même, contrarier l’entendement. On pourrait alors voir l’informe non plus sous sa définition matérielle mais dans une occurrence morale, comme l’expression d’une incapacité à modeler, à conformer un sujet. Dans un registre qui aurait davantage à voir avec le grotesque, cette situation évoque les tribulations de Jojo, le personnage principal de Ferdydurke, le roman de Gombrowicz. Là aussi, l’école et son appareillage normalisant se heurte aux aspérités individuelles, le parti-pris caricatural de l’auteur venant mettre en exergue l’absurdité d’une exigence sociétale en inadéquation avec l’esprit de la jeunesse. Bien qu’elle utilise des procédés stylistiques différents, Farah Khelil interroge la mise en œuvre de l’éducation à travers la présentation d’une carte postale, visible de deux manières différentes dans l’exposition. Légendée « Par l’enseignement scolaire, ménager ou artistique, les Sœurs Blanches préparent la jeune fille à prendre sa vraie place au foyer familial. », la carte montre une classe d’écolières, attablées à leurs pupitres, sous l’auspice « bienveillant » des sœurs. À la surface jaunie de cette mise en scène d’époque, l’artiste intervient en apposant deux types de signes : des points blancs servant de tuteurs aux lettres arabes et un ensemble de petites croix, tracées en noir et organisées en cercle, utilisées en couture pour le point de crochet. Dans les deux cas, l’ordonnancement strict des marques à suivre exacerbe la structure sous-jacente de l’éducation, présentée comme un gabarit façonnant l’enfant afin de lui permettre d’occuper « sa vraie place » au foyer – métonymie domestique de la société.
Il y a donc dans le travail de Farah Khelil, et particulièrement dans l’ensemble des pièces qui occupent l’espace d’exposition de La Boîte, à Tunis, une tendance oscillatoire allant de l’obscurcissement du message – lequel se voit soumis à différentes altérations qui n’en font qu’un signal aveugle – à sa mise en tension critique, révélant métaphoriquement la mécanique qui le sous-tend. Naviguant entre ces deux états, le propos de l’artiste agit sur le regard comme un révélateur de l’instrumentalisation du langage et du voir. Dernier exemple à cela, la vidéo Point de vue, point d’écoute, datant de 2012. On y observe, depuis le sol où la caméra semble avoir été dissimulée, les pieds de femmes chaussés de talons tournoyer, trébucher, s’arrêter puis repartir, au rythme de la musique et des échanges inaudibles et invisibles. De cette entropie de corps fragmentés, où rien d’autre ne se laisse présager que l’intensité d’une fête, se devine à nouveau les contours indéfinissables de l’informe – d’un instant de voyeurisme qui ne peut être lu sans court-circuiter l’ensemble des a priori culturels qui en surgissent.
Et c’est sans doute à cet endroit précis que la production de l’artiste prend le plus de relief, car elle laisse ouverte la porte d’un bouleversement du regard par une exploitation critique de l’art qui contournerait le langage. En échappant ainsi à sa prédominance conceptuelle, Farah Khelil essaime les balises permettant d’en éviter les impasses idéologiques.
Franck Balland
« Si ce qui est beau, c’est l’homme libre, alors ce qui est suprêmement beau, c’est l’homme qui se forme lui-même et qui forme le monde jusque dans ses moindres recoins, jusqu’à l’informe. »
L’INSPIRATION A-T-ELLE DES MAINS OU EST-ELLE SOMNAMBULE ?
Farah Khelil nous a habitués à l’inversion et au renversement des images, et, il faut s’attendre au bouleversement continu avec elle. Après les paysages enduits de blancs pour ne laisser apparaître qu’un soupçon de couleur, voilà qu’elle déplace encore la question de nos libertés sur un autre terrain, car il ne s’agit plus désormais d’être libre mais dans quelle mesure nous avons prise sur la réalité. Farah Khelil ne se limite pas au visible, elle est attentive aux rapports cachés, au non-dit, aux liens que peuvent évoquer les êtres et les choses.
A la manière de Diderot dans sa Lettre sur les aveugles, qui explique qu’un aveugle qui se met soudainement à voir ne comprend pas immédiatement ce qu’il voit, et qu’il mettra du temps à faire le rapport entre son expérience des formes et des distances acquises par le toucher, et les images qu’il perçoit avec son œil ; Farah Khelil de son côté, expérimente sur le plan artistique la question de nos sens. C’est ainsi, qu’elle arrive à nous faire percevoir des sons musicaux en visionnant en silence les pas de danseuses. Comment écouter par le regard, véritable exercice qui nous amène à découvrir une perception synesthésique. Car, si tout apprentissage se fait manuellement entre l’œil qui regarde et les pieds qui rythment une cadence, on découvre que l’on peut aussi écouter non pas le silence, mais l’inaudible.
Mais le dialogue des sens de Farah Khelil ne s’arrête pas là, c’est entre le visible et le tactile qu’elle explore les limites. Partant d’une méthode, aujourd’hui révolue, d’apprentissage de l’écriture, apprentissage mimétique puisqu’il faut relier les points pour retracer les contours d’une lettre et d’une phrase. Cet exercice se transforme en exercice tactile et s’étend sur une vingtaine de phrases modèles. Du visible au tactile, point de Braille, mais, simple pointillé reprenant les points de liaison. Ainsi, joignant le visible au tactile, les planches se superposent au point de s’embrouiller et de ressembler à un nuage brouillant tout sur son passage.
De plus, notons que l’exposition est genrée dans la mesure où les arts manuels sont destinés comme par essence aux filles dont on voit les mains laborieuses s’activer. En revanche, le livre d’apprentissage de l’écriture semble destiné à l’éducation des garçons.
Dans un cas comme dans l’autre, l’éducation reste une re-production, qui, en voulant affranchir l’être, l’aliène davantage.
Hédia Khadhar
« La question du « point de vue », de la doxa, voilà qui est justement au fondement de l’œuvre de Farah Khelil (1980), autre artiste tunisienne
invitée à présenter à La Boîte ses travaux. « Intéressée par la périphérie du regard et par la mise en image du mot, Farah Khelil interroge le point de vue comme condition d’accès à une réalité », indique la présentation, par La Boîte, de son approche très personnelle de l’art : « Khelil détourne et s’approprie objets, légendes, commentaires, citations et archives en installant dans ses œuvres des protocoles de traduction, de
codage, de distanciation et de cécité en usant des jeux de dissimulation et de dévoilement du sens ». Titre de son exposition dans les locaux du Kilani Group : « L’inspiration a-t-elle des mains ou est-elle somnambule ?» Ce titre reprend une phrase du Journal de Paul Klee, peintre européen déjà cité plus avant et connu pour un voyage en Tunisie qui
constituera pour lui une véritable expérience créatrice. Klee s’interroge alors sur ce point crucial, l’origine « pratique » de la création artistique. Est-ce l’intuition, et le cerveau, qui dirigent la main de l’artiste ? À l’inverse, est-ce la main de l’artiste au travail qui émule l’intelligence se représentant la forme tracée ? Bref, l’art est-il une activité manuelle, une activité mentale ou une activité tout à la fois mentale et manuelle ? Prenant à la lettre le questionnement de Klee, Farah Khelil en donne une double illustration, sans trancher, en proposant au spectateur diverses réalisations plastiques structurées par les concepts de création
mentale et de création manuelle, cela, dans le cadre d’« une exposition construite à partir de deux éléments d’archives : un manuel d’apprentissage à l’écriture arabe et une carte postale ancienne de Tunis datant des années 1910 et représentant une classe de filles apprenant la broderie avec les Sœurs Blanches », des religieuses chrétiennes. Cette photographie, cette broderie, Khelil se les réapproprie puis les retravaille à des fins artistiques. La photographie est agrandie et légendée en braille. Une vraie broderie est tissée, légendée au moyen d’une phrase en arabe originelle traduite là encore en alphabet braille. Ces artefacts nés d’un glissement d’images à objets, l’artiste les présente ainsi sous une forme matérielle que le spectateur est invité à palper, à toucher physiquement. L’art cose mentale, « chose mentale » ou cose digitale, « œuvre des mains au travail » ? Chacun fera son opinion, avec ses propres gestes, sa propre palpation, sa propre intellection. »
Paul Ardenne