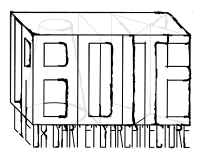- +216 71 772 000
- laboite@kilanigroupe.com
- Du lundi au vendredi, de 11h à 17h.
Haythem Zakaria
«Il manque les noms sacrés»
Janvier 2015 I Juin 2015
La Boîte I Un lieu d’art contemporain
Les trois œuvres de Haythem Zakaria que rencontre ici le spectateur sont différentes stations ou haltes d’un chemin de pensée en dialogue et d’expérimentation artistique. Trois haltes, c’est-à-dire trois retenues : des moments de recul devant la forme et le discours. En chaque moment, dans chaque œuvre, un suspens de l’avancement ininterrompu des procédés de signification ou représentation. Un appel essentiel pour approcher ce qui institue l’intimité de chaque rapport. Du tracé de la ligne à l’installation solide, il ne s’y agit que de l’ouverture d’une dimension où vient ce qui fait l’essence du nom. Du nom propre. Peut-être du nom le plus propre : le nom de Dieu. N’est-ce pas dans la question du nom que se déploie le plus intensément toute la problématique du rapport au monde, aux choses et aux autres, en somme la problématique de notre existence propre ? Un nom, est-il représentable ?
Est-il un objet ? Pour quel sujet ? Est-il traduisible ? Peut-on convertir un nom ? Que reste-t-il de « propre » dans un nom après sa conversion ? Le nom propre fait-il partie de ce qu’on appelle le langage ? Qu’arrive-t-il au nom sacré (c’est-à-dire sauf, intouchable, entier, inentamable, en somme « le plus propre ») quand on veut le transposer dans une autre langue ? Perd-il par là-même sa sacralité ? Devient-il par-là plus « commun » ?
Autant de questions qu’ouvrent les créations de Haythem Zakaria, non pour susciter une seule réponse (comme si c’était possible de leur répondre en une fois). Mais déjà, et par elles-mêmes, surgissant en tant que correspondance à l’appel du nom propre. Puisant dans la tradition mystique tout en la transformant de manière radicale, la démarche artistique de Haythem Zakaria reprend l’histoire des noms sacrés dans leur élément poétique. Chacune des œuvres reprend à sa manière cette histoire et la confronte à l’avenir de notre existence dans un monde de plus en plus réduit à la traductibilité générale par le biais d’un capitalisme qui nivelle tout.
Le triptyque #3 // Alif donne à voir des lignes verticales et des carrés noirs reliés par d’autres lignes qui bordent les angles. Ces lignes de rapport, donnant aussi par leur inclinaison « l’impression » d’une perspective, mettent le spectateur qui regarde dans une dimension spatiale épurée et minimale. Et comme la composition de lettres tracées fait la singularité de chaque nom propre, ici la composition des lignes fait appel à des formes géométriques « presque pures » : des carrés noirs. Cependant, le fond ici n’est pas blanc, mais bien « lignes ». Tracés de limite extrême ou de seuil, par quoi se déterminent le dehors et le dedans, le propre et l’impropre… Mais aussi, et surtout, par quoi est possible le passage, donc la traduction. La ligne à quoi le carré se «rapporte » est ici la même limite à quoi se rapporte tout nom propre, et surtout l’exemple même du nom propre : le nom de Dieu. La limite d’une langue et son seuil de passage à une autre. La limite du langage même, comme appel de l’autre.
Dans l’installation Dhikr, c’est une autre limite qui vient nous faire en- contre : celle de la valeur. De la valeur d’un nom. De la valeur du nom. Se situant entre, d’une part, toute une tradition ésotérique qui cherche des valeurs numériques dans les noms de Dieu. Dans une recherche d’une traductibilité absolue et totale du divin. Et d’autre part, une structure de valorisation capitaliste généralisée. Qui cherche aussi un horizon de circularité absolue des valeurs. Dhikr nous met face à des compteurs manuels mécaniques contenant chacun une valeur numérique correspondant à un nom de Dieu. On se rapporte aux noms de Dieu à travers le nombre : 99 compteurs correspondant aux 99 noms excellents ou beaux. Puis les valeurs de chaque nom affichées sur chaque compteur.
Le nombre ici devient l’élément dans lequel l’appel retentit. Incantation, remémoration, imploration, le Dhikr répète, jusqu’à l’abstraction extrême, l’appel nominatif de l’altérité. Et nous montre une alliance secrète entre le mystique et le capitalistique. Ou plutôt un certain fondement mystique du capitalisme qu’il faut prendre en considération dans chaque analyse critique ou interprétation de notre histoire mondiale. L’installation Sans nom, quant à elle, peut être considérée comme la matrice des deux autres œuvres. Une sorte de champ différentiel de colonnes de granite émergeant de la terre à diverses hauteurs correspondant aux 99 noms divins. Le nom ici prend corps. Se matérialise à partir de la matière terrestre. Le tout disposé comme une chaire primordiale d’où surgit tout appel. L’œuvre sans nom, privée de nom, mais qu’on peut entendre aussi comme « cent noms », met en œuvre la vérité du nom. Son essence surgissant de la terre et s’élevant vers le ciel. Comme le surgissement d’une prière non encore déterminée vers un innommable par excès de noms propres. L’installation Sans nom configure un monde d’où surgiraient les noms sacrés qu’on attend toujours. De la terre vers le ciel, dirigeant le mortel vers le divin, le nom est d’abord une œuvre d’art que l’artiste écoute et accueille pour nous.
Comissaire d’Exposition : Arafat Saadallah.
« Une culture de la différence ? On en retrouve le principe, sur un registre tout autre, dans les travaux plastiques d’Haythem Zakaria (1983), qui aura lui aussi les honneurs de La Boîte. Zakaria est l’artiste des quêtes limites, des interrogations sans fond. Il est aussi un artiste aujourd’hui, ayant recours au dessin aussi bien qu’aux technologies les plus sophistiquées qui soient, numériques et informatiques au premier chef. Comment faire mon autoportrait en cassant le code de l’image reflétée et en exprimant le mouvement de la vie, du vivant intérieur ? Sur des écrans électroniques, l’artiste diffuse de frénétiques séquences d’oscillation électrique, à répétition, puissante métaphorisation de l’activité cérébrale et de ses connections synaptiques incessantes. Plus ambitieux : comment représenter Dieu ou l’absolu, comment, ce faisant,
contourner cette limite implicite à la nature même de l’œuvre d’art, celle du simulacre ? Faire de l’art une maïeutique supérieure, une mathesis universalis, une science de la Révélation, en quelque sorte, tel serait ici le projet poursuivi. Projet fou, imbécile, icarien ? C’est en tout cas dans cet esprit d’introspection faisant flèche de tout bois que Zakaria décide de travailler sur la lettre alif, la première de l’alphabet arabe, réputée selon les mystiques pour être riche d’une symbolique cachée. De quelle façon, artiste, révéler cette symbolique, si elle existe ? Au moyen de quel stratagème rompre le « différend » que l’alif nous oppose en nous
refusant son secret réel ou prétendu ? De cette quête résultent des dessins à la pointe et à l’encre de Chine structurés autour de cadres sombres et mutiques alignés comme en une sévère ponctuation du caché, dessins d’où partent des lignes droites, dans de multiples directions, censées désigner autant d’axes de lecture, de découverte du
sens caché. Sens caché qui, on s’en doute, ne sera pas livré, l’œuvre montrant comme il se doit les limites qui sont les siennes, l’artiste qui les produit n’ayant pas le pouvoir de la divination. Présentée comme suit par La Boîte, l’approche artistique d’Haythem Zakaria donne le ton d’une
création qui brûle au feu de territoires inexplorés : celle-ci, « largement imprégnée de spiritualité soufie, met en œuvre des techniques visuelles
non conventionnelles (glitch, méta-image, ciné-process) qui l’orientent et l’impliquent dans l’expérimentation de dispositifs génératifs en temps réel. Ainsi Zakaria est-il conduit à explorer des procédés visant à ‘’sur réaliser’’ l’image par intégration, greffe, superposition d’informations formelles visuelles ou sonores. Ses créations sont le fruit d’une introspection (…), elles révèlent des univers multiples et insoupçonnés générant comme des partitions visuelles qu’il convient de lire ou déchiffrer par la sensation immédiate et la réflexion. » Où se confronter, spectateur, à la mise en scène non d’une Révélation avec la majuscule
(seul Dieu, s’il existe, peut Révéler) mais à celle d’« une perplexité fécondante », pour reprendre les termes d’Arafat Saadallah, commissaire de l’exposition de Zakaria pour La Boîte. Précisons que l’artiste, à son exposition dans les locaux du Kilani Group, a donné cet intitulé tautologique qui ne saurait dès lors surprendre, « Il manque les noms sacrés » – il manque, pour solde de tout compte, la vérité. Avec à propos, Haythem Zakaria a d’ailleurs pris soin d’accrocher ses dessins à l’aplomb d’une maquette de ziggourat, architecture en forme de tour sur laquelle montaient les astrologues mésopotamiens pour s’approcher de la voûte céleste et tenter d’en percer les secrets. Une tour de Babel posée pour l’occasion à même le sol, comme un dérisoire amas de briques verticales. Pouvoir de l’art, oui, mais pas tout le pouvoir. »
Paul Ardenne